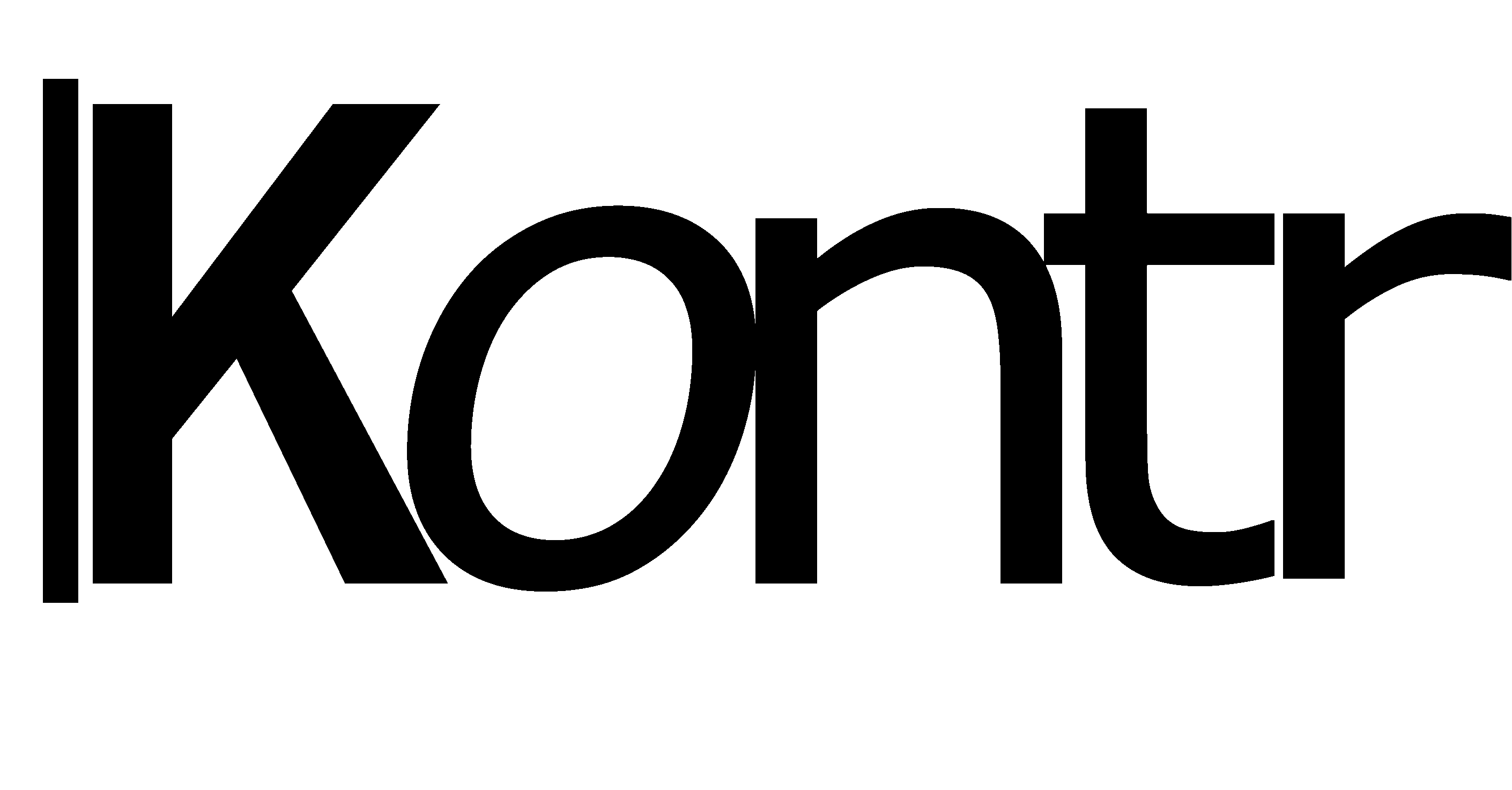Traduire (juste) n'est pas tuer
On use tant et plus, un peu partout, un peu tout le temps, de l’expression « bonne traduction ». Quand on (se) demande, par exemple : qu’est-ce qu’une bonne traduction, à quoi reconnaît-on une bonne traduction, etc. Mais c’est éluder une réalité tellement évidente qu’on n’y pense jamais, et qui reste particulièrement valable pour les langues minorées comme le turc : avant de se demander si une traduction est bonne, il faut se demander si elle juste.
Un éditeur m’a posé cette question récemment : « Comment je peux savoir si votre traduction est bonne ? » Victime encore une fois de mon esprit d’escalier, je n’ai trouvé la seule réponse possible qu’une fois dans les escaliers, justement : votre lecture ne sera entravée par aucune bizarrerie ne pouvant être, de toute évidence, du fait de l’auteur. Je ne suis malheureusement pas remonté le lui dire.
Ferda Fidan[1] a récemment révélé dans Cumhuriyet[2] le scandale que constitue la traduction de Tol, de Murat Uyurkulak, publiée aux éditions Galaade en 2010[3]. M. Fidan y démontre, moult exemples à l’appui, que le caractère calamiteux de ce travail provenait du fait que le traducteur en question ne maîtrisait pas vraiment le turc. Pourtant, il jouissait d’une excellente réputation dans le milieu de l’édition de littérature turque en France, si l’on en croit le nombre de traductions qu’il a signées au fil des ans. À lire les nombreux exemples de fautes très basiques relevées par M. Fidan, le « trahir » du proverbe est ici manifeste, mais il me semble qu’on ne peut l’invoquer que pour une trahison juste, car comment concevoir qu’une traduction publiée ne soit pas juste, c’est-à-dire, pour le moins, que le traducteur n’ait pas conclu un accord moral avec lui-même, conscient d’avoir un niveau de maîtrise suffisant et se promettant de faire le meilleur travail possible, ne serait-ce que par respect pour l’auteur ?
Au-delà de la question de la maîtrise et de la justesse, qui relèvent de l’honnêteté intellectuelle, il y en a une qui relève beaucoup plus directement de la fidélité. Et je ne sais pas laquelle a vraiment perturbé ma lecture de Tol, quand j’ai essayé de le lire après l’avoir acheté en librairie à sa sortie (avant de déclarer forfait – épuisé et passablement énervé d’avoir à relire plusieurs fois le même paragraphe pour essayer de comprendre ce qui se passait – peu après la page 133, si j’en crois la pliure du dos). C’est la question de la voix (je parlais le mois dernier de la « petite musique de l’olivier », on n’en est pas loin). Bien sûr, un traducteur traduit des mots, des phrases, du discours (j’y reviendrai un jour), mais il conduit aussi à travers les langues la voix de quelqu’un qui écrit. Et le mieux que l’on puisse attendre d’un texte traduit, c’est d’y entendre en le lisant la voix qu’un auteur aurait eu si cette langue avait été la sienne.
Voici un exemple que j’ai donné chaque début d’année aux étudiants de mon cours de traduction à l’université de Strasbourg tant que ma mission d’enseignement y a duré. Il s’agit de la première phrase de Tol. L’incipit emblématique d’un livre qui ne l’est pas moins, et que j’ai été stupéfait d’entendre réciter par cœur par plus d’un ami avec qui j’ai pu aborder le sujet. La voici en turc (1), suivie de la version publiée (2) et enfin d’une traduction plus juste (3).
(1) Devrim, vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi.
(2) Autrefois, la révolution était une fort séduisante possibilité.
(3) Il y a eu un moment où la révolution était une possibilité, et c’était très beau.
Sans vouloir gloser sur la mauvaise, pardon, sur la fausse lecture du traducteur, que vous aurez aisément diagnostiquée, je voudrais juste attirer votre attention sur le problème que sa traduction présente relativement au respect de la voix. Qu’est-ce que ce « fort séduisante » vient faire dans la bouche de ce narrateur révolutionnaire qui s’exprime dans un registre familier ?
*
C’est il y a quelques années, je rejoins un ami dans le jardin d’un café de Yeldeğirmeni. Sur la table, la traduction turque de Zazie dans le métro[4]. La question fatidique tombe : « Est-ce que c’est une bonne traduction ? » Premier réflexe, dire que je ne peux pas le savoir puisque je ne l’ai pas lue. Deuxième réflexe, regarder le nom du traducteur sur la couverture. Tahsin Yücel ? Un homme qui jouit d’une certaine réputation d’écrivain et de traducteur en Turquie comme en France[5]. Soudain, je me rappelle ma découverte du livre[6] dans la bibliothèque du collège Louis Aragon de Mably et ma réaction (hilarité, incrédulité, enthousiasme communicatif) à la lecture du premier mot. Troisième réflexe, curiosité, comment cet incipit parmi les plus frappants de l’histoire littéraire a-t-il été traduit ? Et là, consternation.
« Doukipudonktan » est devenu « Neden bunca pis kokarlar ki ».
Évidemment, je referme immédiatement le livre et dis à mon ami quelque chose comme : « Non, cette traduction est atroce. » Fut-ce exagéré ? Sans doute. Reste que :
Ce fondateur de l’Oulipo qu’est Raymond Queneau, quand il décide d’ouvrir son livre sur cette phrase condensée en un seul mot et transcrite phonétiquement, crée un effet comique, un effet d’oralité, et annonce, comme en un manifeste, que son livre repose sur l’argot ainsi que sur une conception ludique du langage. Et tout cela a été gommé d’un trait dans la traduction, en rétablissant la phrase que Queneau avait sciemment comprimée.
Passant par la rétrotraduction, on obtient en effet : « Pourquoi puent-ils donc tant ? » Que reste-t-il de l’intention de Queneau dans cette traduction « mot-à-mot » ? Mais surtout, est-ce que cela nous dit quelque chose de la compréhension de l’œuvre par Tahsin Yücel ? D’accord, quelques lignes plus loin, on trouve bien un « Demindedini » s’efforçant de respecter la contraction de « Skeutadittaleur ». Mais dans le même temps, « Barbouze » et « Fior » sont restés en français dans le texte, demeurant incompréhensibles pour le lecteur turc. Perplexité.
*
Ce n’est donc pas parce qu’une œuvre est traduite qu’elle passe, qu’elle est passée par un passeur. Difficile, hélas, pour un lecteur de traduction de diagnostiquer la justesse de ce qu’il lit. Mais ce sont des choses que l’on ressent. Et quand on ressent ce que j’ai ressenti, par exemple, à la lecture de Tol, il y a de fortes chances que l’on soit refroidi par l’expérience et que l’on hésite à la renouveler. La pire des conséquences possibles étant de faire une croix sur l’ensemble du pays ci-traduit, ce qui peut se révéler tragique pour des littératures circulant déjà peu. Qu’importe donc que traduire soit ou ne soit pas trahir, que traduire soit ou ne soit pas tuer, quand (ne pas) traduire (juste), c’est potentiellement faire tant de dégâts.
Sylvain Cavaillès
[1] Traducteur à qui l’on doit de pouvoir lire en français Ayfer Tunç, Ece Temelkuran, Enis Batur, Fatma Tülin, İhsan Oktay Anar, Mario Levi, Özdemir İnce, Selçuk Altun, Şule Türker, Yakup Kadri et Yusuf Atılgan.
[2] L’un des principaux quotidiens d’information en Turquie.
[3] https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/uyurkulakin-tol-adli-romanini-ceviren-jean-descattan-bir-ceviri-faciasi-1988480
[4] Zazie Metroda, Raymon Queneau, trad. Tahsin Yücel, Sel Yayınları, 2011. Première édition en turc en 2003.
[5] fr.wikipedia.org m’apprend même qu’il a été le « premier disciple en date » de Greimas et qu’il a introduit la sémiotique en France.
[6] Dans la merveilleuse collection 1000 Soleils de Gallimard, pour qui l'a connue.