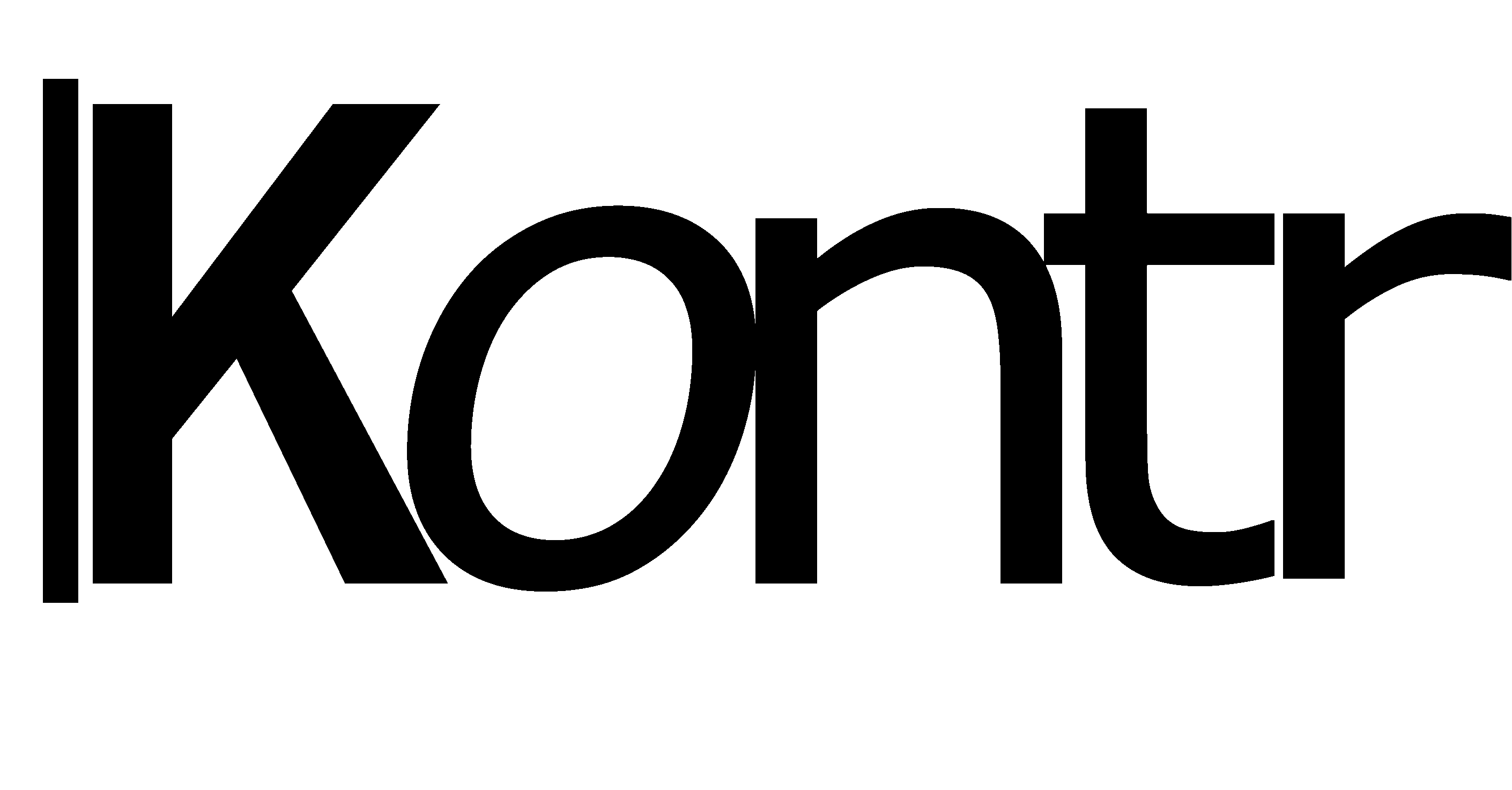Traduire le féminin
La question se pose, dès lors que ce titre est posé : comment faut-il expliquer, s’il faut l’expliquer, qu’en tant que traducteur-éditeur, sur dix-huit des livres que j’ai publiés chez Kontr entre le 1er mai 2017 et le 25 août 2022, quinze soient des livres écrits par des hommes ? Répondre à cette question ici m’éloignerait sans doute du sujet qui nous occupe, la traduction, et déborderait beaucoup du cadre de cet article. Une réponse succincte et temporaire, qui nous permettrait d’avancer sans pour autant qu’elle soit juste, même si elle est honnête, serait de mettre en avant la sensibilité. Car c’est celle que j’avance quand on me demande comment je choisis les textes que je traduis. Mais cette sensibilité est-elle unique, relevant de l’individu que je suis, ou se décline-t-elle en fonction des rôles que j’endosse tour à tour, lecteur, écrivain, traducteur, et oui, éditeur ? Cette réponse nous amènerait à nous interroger sur le genre d’une œuvre, ou au moins celui d’une écriture. Y a-t-il des livres masculins et des livres féminins, les premiers étant ceux écrits par des hommes, les seconds par des femmes ? Auquel cas, faudrait-il recommander que les premiers soient traduits par des traducteurs et les seconds par des traductrices ?
Est-ce ce présupposé qui m’a poussé, lorsque j’ai décidé de publier Je nais de mes racines, de Tomris Alpay, à en confier la traduction à une amie universitaire avec j’avais participé, en 2013, à un atelier de traduction organisé par le CNL et le TEDA[1] ? Est-ce que je pensais qu’une femme serait la plus apte à transmettre la sensibilité féminine de ce livre ?
Reste que lorsque cette amie m’a déclaré, de longs mois plus tard et alors qu’il devenait pressant de faire paraître le livre, que sa charge de travail ne lui permettrait pas de le mener à bien, j’ai dû mettre à l’écart ce genre de considérations et me suis plongé dans cette traduction sans plus y penser.
Je devais avoir déjà bien avancé dans le livre quand un petit événement m’a ramené à l’esprit cette question du genre de l’écriture. Je préparais la publication de Zabel, la pièce de théâtre d’Aysel Yıldırım et Duygu Dalyanoğlu, (traduite par Candan Keten Menteş, une de mes anciennes étudiantes de l’Université de Strasbourg), et je venais d’écrire le texte de la quatrième de couverture, texte que j’ai fait lire à une collègue enseignante. Une pièce écrite par deux femmes, donc, et avec un parti pris féministe : elle raconte la vie de l’intellectuelle Zabel Essayan en en mettant uniquement en jeu les personnages féminins. Ma collègue a lu le texte une fois, puis une deuxième fois, et peut-être même une troisième, après quoi elle m’a dit : « C’est exprès que tous les noms communs sont féminins ? » J’ai relu le texte à mon tour pour constater qu’elle disait vrai : en écrivant ce texte, je n’avais pas utilisé un seul mot masculin. Il y aurait donc, dans l’écriture, vraiment, des processus qui, oui, vraiment, nous échappent absolument. Exit donc, a priori, la question du genre de la personne qui traduit vs celui de celle qui écrit.
J’ai encore à l’esprit, très vivace, une bribe de conversation datant de 1997 entre deux comédien·ne·s que je dirigeais dans Vous qui habitez le temps, de Valère Novarina. La « Femme aux chiffres » demandait au « Chercheur de Falbala » : « Est-ce que tu as conscience de la part de féminité qui est en toi ? » J’avais été subjugué par cet instant magnifique où le profond questionnement du « Chercheur de Falbala » se donnait à lire sur son visage. Où en sommes-nous, vingt-cinq ans plus tard, par rapport à cette vérité, que cohabitent en tout individu, sans s’annuler, sans avoir à se définir, sans avoir à influer sur son genre, une part de masculin et une part de féminin ? Y a-t-il encore de la vérité dans cette vérité, ou serait-il opportun que je me présente, ce qui ne me déplairait pas, comme traducteur non binaire ?
*
Aujourd’hui, cela fait plus de deux mois que Je nais de mes racines est sorti en France. Le livre a reçu un bel accueil en librairie et dans l’univers du bookstagram. En turc, le titre est une triade de prénoms féminins : Gülsün, Ağavni, Zilha. Son histoire éditoriale est intéressante. Il a d’abord paru en août 2018, dans une maison d’édition féministe, Ayışığı, dont il a été l’un des derniers livres, les éditrices ayant malheureusement mis la clé sous la porte quelques mois plus tard. En 2019, il a reçu le prix Yunus Nadi de la nouvelle. J’ai fait connaissance avec Gülsün, Aghavnie et Zilha le 18 octobre 2019. C’est M. Yann de Lansalut, alors encore directeur du lycée Notre-Dame-de-Sion, qui me l’a offert à la suite de la cérémonie de remise du prix des lycéens, reçu cette année-là par Kemal Varol, dont je préparais la publication de Ouâf et que j’y avais accompagné. Quelques jours ou semaines plus tard, le livre de Tomris Alpay connaissait une seconde vie aux éditions Aras, spécialisées dans la littérature et les études arméniennes. Pour le rendre plus facilement identifiable en France, nous avons intitulé la traduction française à partir du titre de l’une des nouvelles, mais Gülsün, Aghavnie et Zilha sont bien présentes dans la magnifique couverture conçue par Umut Pehlivanoğlu.
Tomris Alpay nous entraîne rue du lierre, dans le quartier stambouliote de Kumkapı où vivent des femmes turques, arméniennes, roumes, dans l’amitié et la solidarité, dans le présent des années 1950 et le passé tourmenté de leurs histoires respectives. En treize nouvelles irriguées des liens tissés des unes aux autres par l’autrice, elles écrivent un roman de la condition féminine de l’époque, évoquant les joies du vivre ensemble, la valeur incomparable de l’affection mais aussi la polygamie, les espoirs déçus, les coups du destin, les déracinements et les violences de l’histoire.
« La petite musique de l’olivier » – que Tomris Alpay me permette de reprendre cette expression – n’est pas forcément ce que j’ai cherché à convoyer en écrivant cette traduction, mais c’est sans doute elle qui m’a guidé tandis que je voyageais de la rue du lierre à Ténédos, des souterrains de Constantinople aux rues à feu et à sang de Beyoğlu en compagnie de ces femmes, car ce qui lie ces histoires à la fois méditerranéennes et anatoliennes, ce n’est rien d’autre qu’elle. Rendre la musique, c’est peut-être ça, au bout du compte, traduire le féminin ?
Sylvain Cavaillès
[1] Le Centre National du Livre a participé pendant plusieurs années au TEDA, programme du ministère turc de la culture et du tourisme destiné à développer la traduction de la littérature turque vers les langues du monde. La session 2017 avait été brillamment animée par Rosie Pinhas Delpuech.